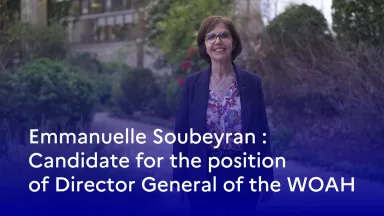Plus d’inclusivité pour renforcer l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA)
Partager la page
L’OMSA a été créée, sous le nom d’OIE, il y a 100 ans par 28 pays, traduisant concrètement le constat que la lutte contre une épidémie ne peut se limiter à un territoire national et qu’elle doit être l’effort de tous.
Au fil des ans, l’OMSA a grandi et compte maintenant 183 membres soit un nombre comparable à celui de l’OMS (194) ou de la FAO (195).
Avec un si grand nombre de membres la question de l’inclusivité se pose. Comment faire en sorte que les tous les membres se sentent impliqués, que leurs problématiques soient bien considérées ? Comment garder l’organisation attractive ? Ces questions sont revenues souvent lors des nombreux échanges en visio et en présentiel que j’ai eus avec les délégués du monde entier.
Une organisation plus inclusive est une de mes priorités.
Que peut-on faire pour une OMSA plus inclusive ?
Tout d’abord l’inclusivité sous-tend une bonne représentativité des régions et des sous-régions au sein des différentes instances de l’organisation. Le siège et en particulier le comité exécutif au niveau de la direction générale doit être organisé en ce sens afin que les postes à responsabilité soient bien le reflet de la diversité des membres et des régions.
Dans le cadre de ma candidature je m’engage à faire du comité de direction de l’OMSA une équipe miroir de nos membres, expérimentée sur les sujets que nous devons traiter.
S’agissant du conseil, le faible nombre de membres du conseil actuel ne permet pas cette bonne représentation. Les travaux à venir sur les textes fondamentaux devront apporter une réponse à cette question.
Dans le cadre de ces travaux, je m’engage à proposer aux membres une révision, à budget constant, de la composition du conseil pour augmenter le nombre de ses membres.
Cet enjeu de représentativité doit également s'appliquer aux départements ainsi qu'aux commissions et groupes de travail, ce qui sous-tend aussi un renouvellement de l’expertise pour que l’expertise de toutes les régions puisse être valorisée et qu’ainsi l’organisation gagne en attractivité en particulier pour les jeunes.
Plus d’inclusivité, c’est aussi des traductions plus rapides des documents de travail et à moindre coût, efficience rendue aujourd’hui possible par un usage prudent de l’intelligence artificielle par nos interprètes. Cela concerne notamment les normes validées traduites dans de nombreuses langues et mises à disposition de tous pour une meilleure appropriation, compréhension et in fine application des normes.
Plus d’inclusivité, c’est – autre exemple – le souci de faciliter le travail des délégués et des services vétérinaires via la systématisation de messages courts permettant au délégués d’identifier rapidement les changements importants dans un projet de norme ou bien les actions à conduire.
Plus d'inclusivité c'est aussi dynamiser le réseau des points focaux en améliorant l'offre de formation qui leur est destinée (en présence et à distance), en lien avec les représentations régionales, pour renforcer le rôle des Délégués et appuyer les services vétérinaires nationaux.
L’inclusivité doit aussi être favorisée par une bonne utilisation des nouveaux outils de communication et partages d’information. En effet, nos régions et nos continents ne sont plus séparés de la même distance si nous les raisonnons en liaisons internet et non plus en liaisons aériennes ; en postes télé-travaillés dans les pays d’origine avec réunions régulières de cohésion plutôt qu’en postes permanents dans les sièges régionaux. Nous pouvons donc repenser nos commissions, nos équipes régionales, notre équipe nationale et notre mode de travail en groupe en y associant ces collègues compétents de tous horizons.
Plus d’inclusivité, c’est enfin un dialogue direct entre les membres élus des bureaux des commissions régionales ainsi que les délégués de tous les membres « petits » et « grands », et le comité de direction de l’OMSA, dialogue que je m’engage à nourrir avec les délégués comme j’ai commencé à le conduire en tant que candidate. Ce dialogue est incontournable pour entendre, comprendre et traiter ensemble toutes les problématiques des régions et sous-régions. La direction générale de l’OMSA doit être présente auprès des délégués pour appuyer leur action auprès de leurs décideurs et assoir la légitimité de leur action en terme de santé animale avec des impacts sur la sécurité alimentaire, le commerce et l’économie, la santé publique et la préservation de la biodiversité.
Gardons toujours en tête que l’inclusivité de l’OMSA est consubstantielle à sa puissance d’action et à son attractivité !
Voir aussi
Le programme d'Emmanuelle Soubeyran
25 mars 2024International

Video - Emmanuelle Soubeyran: candidate for the position of Director General of the WOAH
08 avril 2024Santé / Protection des animaux