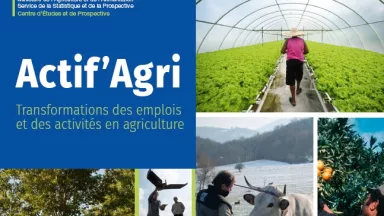Formation continue et reconversions professionnelles vers l'agriculture
Partager la page
Les notes d’Analyse présentent en quatre pages l’essentiel des réflexions sur un sujet d’actualité relevant des champs d’intervention du ministère de l’Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire. Selon les numéros, elles privilégient une approche prospective, stratégique ou évaluative.
Au moment où le renouvellement des actifs agricoles est un défi déterminant, les parcours à l’installation s’ouvrent à des personnes en reconversion professionnelle venant d’horizons divers. Dans ce contexte, la formation continue agricole constitue une étape importante, en donnant accès à des diplômes. L’analyse d’une formation de brevet professionnel « responsable d’entreprise agricole » et de son public montre la variété des profils engagés et leur confrontation à la réalité du métier d’agriculteur. Elle souligne aussi les opportunités offertes par l’obtention d’un diplôme, ainsi que ses limites pour entrer en agriculture.
Ce texte a été rédigé par un chercheur dans le cadre d’une collaboration avec le Centre d’études et de prospective à l’occasion de son intervention lors d’une « Rencontre du CEP ». Les Rencontres du CEP réunissent de manière informelle chercheurs, experts et membres de l’administration autour de la présentation et de la discussion de travaux de recherche sur des sujets prioritaires pour les politiques du ministère. Ce texte n’exprime donc pas les positions officielles du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
Introduction
En France, comme dans la plupart des pays de l’OCDE1, la question du renouvellement des actifs est au cœur des préoccupations actuelles concernant le monde agricole. Face à la diminution du nombre d’exploitations et au recul de l’âge moyen des exploitants2, un Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture a été présenté par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire3. Dans le même temps, les parcours d’installation se sont complexifiés : les enfants d’agriculteurs ont des activités professionnelles dans d’autres secteurs avant de s’installer, la reprise des exploitations se fait de plus en plus en dehors du cadre familial et des personnes non issues du monde agricole souhaitent y consacrer une partie de leur carrière.
Pour mieux comprendre ces évolutions de trajectoires professionnelles, une recherche a été conduite sur une étape encore peu étudiée des reconversions vers l’agriculture, celle de la formation continue. En effet, l’obtention d’un diplôme agricole équivalent au baccalauréat, comme le Brevet professionnel responsable d’entreprise agricole (BPREA), donne accès à la capacité professionnelle et aux aides publiques à l’installation, pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros. Ces ressources financières sont d’autant plus nécessaires qu’elles compensent, en partie, l’absence d’héritage productif4. Ainsi, les Centres de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA), chargés de la mise en œuvre du service public de formation continue agricole, sont des institutions clés dans les parcours de reconversion professionnelle vers l’agriculture.
Historiquement créés pour lutter contre l’inégalité des chances en assurant la formation et la promotion des travailleurs agricoles, les CFPPA font aujourd’hui partie intégrante de l’appareil public de formation continue. Ils étaient 28 à leur création en 1968 et sont désormais 156 répartis sur l’ensemble du territoire. En 2018, 75 % des volumes horaires réalisés au sein de ces centres publics ont été consacrés à des formations diplômantes ou à finalité professionnelle5. Parmi elles, les formations préparant au BPREA constituent leur cœur d’activité. Elles sont de plus en plus ouvertes à de nouveaux publics.
L’enquête a été centrée sur un CFPPA d’une région très urbanisée, préparant à un BPREA spécialisé en maraîchage biologique destiné aux salariés et demandeurs d’emploi bénéficiaires de dispositifs dédiés. Une observation participante6 et des entretiens semi-directifs répétés, pendant et à l’issue de la formation, ont été conduits auprès d’une classe de 15 stagiaires de la promotion 2017-2018 (le dernier entretien date de 2021). Les dossiers des 127 stagiaires ayant suivi cette formation entre 2015 et 2019 ont ensuite été traités afin d’identifier les caractéristiques sociodémographiques ainsi que les trajectoires scolaires et professionnelles. Enfin, les archives du ministère de l’Agriculture et celles du CFPPA ont été analysées pour retracer plus largement les dynamiques socio-historiques de transformation de l’offre de formation en agriculture.
Afin d’étudier la place du diplôme agricole dans les parcours de reconversion professionnelle vers l’agriculture, la première partie de cette note décrit le public qui suit la formation, ses aspirations et la façon dont il appréhende le passage par le BPREA. La seconde partie présente les opportunités offertes par l’obtention du diplôme agricole et ses limites dans les parcours d’installation.
Parcours et aspirations des apprenants
D’abord destinés à élever le niveau de formation des agriculteurs, les CFPPA ont connu des transformations importantes depuis les années 1980. Contrairement à d’autres centres publics de formation, certains CFPPA ont eu une forte croissance d’activité. Face à la diminution de leur public d’origine, une partie d’entre eux ont fait évoluer leur offre. Ainsi, le BPREA étudié, initialement spécialisé en grandes cultures et destiné aux agriculteurs, enfants d’agriculteurs et salariés agricoles locaux, est aujourd’hui consacré au maraîchage biologique. Il s’adresse à de nouveaux publics, éloignés du monde agricole, bénéficiant de dispositifs destinés aux salariés et aux demandeurs d’emploi. Seul habilité à dispenser ce diplôme dans la région, ce CFPPA connaît une forte demande et accueille annuellement plusieurs dizaines de stagiaires.
Un public hétérogène qui converge vers un modèle agricole alternatif
L’accès au BPREA dépend du statut d’emploi. Premièrement, le congé individuel de formation (CIF) permet aux salariés de suivre individuellement, et à leur initiative, une formation de longue durée. Elle concerne principalement les salariés en CDI dont l’ancienneté est égale ou supérieure à vingt-quatre mois consécutifs, et qui doivent élaborer un dossier auprès du fonds de gestion des CIF7 ou, dans certains cas, auprès de leur organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), en charge de la sélection des dossiers. Dans ce cas, les stagiaires continuent à être salariés de leur entreprise. Le FONGECIF prend en charge leur rémunération et le coût de la formation.
La deuxième voie d’accès concerne les demandeurs d’emploi. Les lois de décentralisation8 ont confié aux Conseils régionaux le financement des places de stagiaires, par le biais de marchés publics. Le recrutement des demandeurs d’emploi offre davantage de liberté aux centres de formation qui sont chargés d’attribuer les places financées.
C’est également le cas pour la troisième voie d’accès au BPREA, qui concerne principalement les agents de la fonction publique et les indépendants, contraints de financer eux-mêmes la formation (11 000 euros). Les premiers peuvent continuer à percevoir leur revenu mais ils doivent ensuite trois années à l’État. Pour les indépendants, Pôle emploi peut dans certains cas prendre en charge le coût de la formation mais pas les indemnités, ce qui rend particulièrement onéreux son suivi pendant 9 mois. Entre 2015 et 2019, la formation en BPREA maraîchage biologique étudiée a majoritairement accueilli des demandeurs d’emploi (59 %), un gros tiers de personnes en CIF (36,9 %) et peu de personnes autofinancées (4,1 %).
À l’image de l’enseignement agricole secondaire, qui accueille aujourd’hui un public diversifié9, cette formation en BPREA maraîchage biologique est suivie par des personnes de profils variés, comme le montre l’origine professionnelle des 127 personnes présentes entre 2015 et 2019 (tableau 1) : 18 % d’entre elles sont issues des cadres et professions intellectuelles supérieures, 32 % des professions intermédiaires, 22 % du groupe des employés. Parmi les 23 % d’ouvriers ayant participé à la formation, seulement un tiers sont des ouvriers agricoles. Pour la plupart d’entre eux, il s’agit d’une première expérience dans le processus de reconversion avant de commencer la formation.
Tableau 1 – Données sociodémographiques des stagiaires du BPREA maraîchage biologique du CFPPA étudié, de 2015 à 2019
|
2015/2016 |
2016/2017 |
2017/2018 |
2018/2019 |
Effectif cumulé |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statuts |
En emploi |
7 (39 %) |
15 (38 %) |
15 (50 %) |
20 (51 %) |
57 (45 %) |
| Denier emploi occupé |
Ouvriers |
4 (22 %) |
12 (30 %) |
5 (17 %) |
8 (21 %) |
29 (23 %) |
|
Employés |
5 (28 %) |
8 (20 %) |
8 (27 %) |
7 (18 %) |
28 (22 %) |
|
|
Professions |
6 (33 %) |
10 (25 %) |
8 (27 %) |
17 (44 %) |
41 (32 %) |
|
|
Cadres, professions |
3 (17 %) |
8 (20 %) |
7 (23 %) |
5 (13 %) |
23 (18 %) |
|
|
Autres et non renseigné |
0 (0 %) |
2 (5 %) |
2 (7 %) |
2 (5 %) |
6 (5 %) |
|
| Diplôme obtenu |
< Bac |
2 (11 %) |
4 (10 %) |
4 (13 %) |
5 (13 %) |
15 (12 %) |
|
Bac |
7 (39 %) |
12 (30 %) |
9 (30 %) |
7 (18 %) |
35 (28 %) |
|
|
> Bac |
9 (50 %) |
24 (60 %) |
17 (57 %) |
27 (69 %) |
77 (60 %) |
|
|
Dont agricole |
0 (0 %) |
0 (0 %) |
2 (7 %) |
1 (3 %) |
3 (2 %) |
|
| Âge |
19-33 ans |
11 (61 %) |
22 (55 %) |
15 (50 %) |
25 (64 %) |
73 (57 %) |
|
34 ans et + |
7 (39 %) |
18 (45 %) |
15 (50 %) |
14 (36 %) |
54 (43 %) |
|
| Sexe |
Femme |
7 (39 %) |
15 (38 %) |
11 (37 %) |
21 (54 %) |
54 (43 %) |
|
Homme |
11 (61 %) |
25 (62 %) |
19 (63 %) |
18 (46 %) |
73 (57 %) |
|
| Total |
18 |
40 |
30 |
39 |
127 |
Source : auteur, à partir des dossiers des stagiaires du centre de formation.
Trois types de parcours : les désenchantés, les déclassés, les détachés
Les entretiens biographiques et l’analyse des dossiers de candidature des 15 stagiaires suivis par nous restituent les trajectoires scolaires et professionnelles de ces candidats, ainsi que leur rapport initial à l’agriculture. Ils peuvent être répartis en trois groupes : les « déclassés » (7 cas sur les 15 stagiaires), les « désenchantés » (5/15) et les « détachés » (3/15). Ces parcours contrastés expliquent leurs différentes aspirations pour l’agriculture et la formation, et la façon dont ils les ont formulées avant leur entrée en CFPPA.
Les déclassés sont plutôt des jeunes hommes issus de familles qui accordaient beaucoup d’importance à la scolarité, mais qui n’ont pas pu convertir leur investissement scolaire en statut professionnel. Ils détiennent tous un baccalauréat mais ils ont abandonné leurs études supérieures pour occuper des positions subalternes du salariat. Leur aspiration à l’agriculture se fait moins en rupture qu’en continuité avec leur parcours. Certains cultivaient déjà des légumes au sein de jardins associatifs ou familiaux, avant l’entrée dans la formation, et ils ont appris à entretenir un potager lors de vacances chez des grands-parents agriculteurs, ou lors de luttes d’occupation comme à Notre-Dame des Landes. Ils sont également plusieurs à être passés par des emplois dans la distribution, où ils ont acquis des connaissances en matière de commercialisation et de gestion de la qualité des produits alimentaires. En intégrant une formation en maraîchage biologique, il s’agit pour eux de trouver une voie de reclassement valorisant professionnellement leurs pratiques d’autoproduction et leur connaissance des produits alimentaires.
Les désenchantés partagent avec les déclassés un investissement familial relativement important dans le domaine scolaire. Dans leur cas, il s’est concrétisé par l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Titulaires de diplômes pouvant aller jusqu’au doctorat, ils ont eu accès à des emplois stables d’encadrement et de direction. Ces emplois salariés leur ont permis d’avoir des situations financières avantageuses (propriétaires de leur résidence principale et parfois d’une maison secondaire). Mais ils ont vécu des crises qui les ont conduits à un « désenchantement professionnel10 ». L’accès au statut d’indépendant est alors perçu comme un moyen de mieux conjuguer leurs vies professionnelle et familiale, tout en valorisant leurs compétences. Comme pour les déclassés, la distance à l’agriculture est moins grande qu’elle ne peut s’observer au travers des catégories statistiques. Ils sont relativement proches du monde agricole, en tant qu’enfants ou petits-enfants d’agriculteurs, ou parce qu’ils ont une activité professionnelle au sein du secteur agricole (presse agricole, chantier d’insertion, vétérinaire). Pour autant, leur connaissance des pratiques agricoles était superficielle avant l’entrée dans la formation. Cette entrée est pour eux le moyen d’acquérir une légitimité professionnelle par le diplôme et de se préparer à une nouvelle activité professionnelle à connotation écologique, valorisée socialement et symboliquement.
Enfin, les détachés sont âgés de plus de 40 ans et ils ne peuvent donc plus prétendre au dispositif public d’aide à l’installation. Leurs parcours scolaire et professionnel ont été moins favorables que ceux des membres des deux autres groupes. Leur titre scolaire a une plus faible valeur que celui des autres stagiaires, soit parce qu’il est d’un niveau inférieur, soit parce qu’il s’est dévalué avec le temps. Ils ont changé plusieurs fois de secteurs d’activité, mais en restant dans des emplois peu qualifiés. Ces stagiaires sont relativement détachés des enjeux professionnels et ils peuvent s’appuyer sur leur conjoint qui ont des emplois plus stables (dans la fonction publique par exemple), pour suivre une nouvelle formation. Celle-ci est pour eux moins un enjeu professionnel qu’un outil de développement personnel.
La formation continue : appréhender la réalité du métier
Le dispositif de formation du BPREA n’est pas sans contraintes sur les stagiaires. Devoir concilier le temps de formation et les autres activités familiales les met en situation d’urgence, surtout pour celles et ceux qui ont des enfants. La grande diversité des enseignements (comptabilité, agronomie, biologie, production, travaux pratiques) est également une source importante d’incertitude, notamment pour ceux qui ont suivi des cursus généraux. Enfin, le caractère éprouvant du métier de maraîcher crée de l’inquiétude chez les stagiaires les plus âgés et chez ceux qui ne sont pas habitués à travailler physiquement.
Les formateurs utilisent ces incertitudes pour confronter les stagiaires à la réalité du métier de maraîcher, marqué par une certaine marginalité économique et professionnelle. Or, cette marginalité, nouvelle pour une grande partie des stagiaires, doit s’intégrer dans un cadre économiquement rentable au sein du projet, principal support d’évaluation de fin d’année. Cela renforce le sentiment d’un long trajet à accomplir, qui s’exprime dans les dossiers des stagiaires, où sont mis en récit de manière explicite leur parcours. Ils le scindent entre un « avant » et un « après » la formation, qui est alors présentée comme le moment ayant permis de « passer du rêve à la réalité ».
Les usages du diplôme agricole : opportunités et limites dans les parcours de reconversion
Alors que le taux d’échec au BPREA est très faible11, l’accès au métier d’agriculteur reste difficile pour les anciens stagiaires. Rares sont celles et ceux qui deviennent agriculteurs immédiatement après la formation. Au-delà des quelques cas d’installation rapide (3 cas sur les 15 stagiaires suivis), les entretiens réalisés ont permis de faire apparaître deux autres types de parcours : devenir ouvrier agricole (5/15), ou renoncer (parfois provisoirement) à l’agriculture (7/15, dont une personne qui n’a pas été diplômée).
L’installation rapide
L’installation rapide concerne surtout les désenchantés qui ont des ressources économiques importantes. La détention d’un BPREA n’est pas une condition suffisante pour devenir agriculteur, puisque ce diplôme ne peut compenser entièrement l’absence de terres, dont la disponibilité passe principalement par les circuits familiaux et professionnels12. Dès lors, l’accès au foncier se fait par d’autres voies, notamment auprès des collectivités locales qui disposent de terres à concéder.
Nombreux sont les stagiaires à être issus directement ou indirectement du monde agricole. La mise en avant de cette filiation peut constituer une stratégie pour faire valoir une proximité avec l’agriculture, au moment d’entrer dans la formation par exemple, mais elle n’en est pas moins réelle pour un certain nombre d’entre eux. Dans ces cas, devenir agriculteur constitue certes une mobilité professionnelle importante mais qui témoigne en même temps d’un retour au milieu d’origine.
Les vacances passées chez des grands-parents agriculteurs ont pu participer à la construction d’une vision idyllique et même romantique de l’agriculture. L’appartenance à des familles d’agriculteurs peut également faciliter l’accès à certaines ressources, comme le foncier. Lors de nos entretiens, ils sont pourtant nombreux à avoir mentionné les difficultés rencontrées avec leurs parents ou grands-parents, au moment de leur annoncer leur volonté de devenir agriculteur. L’aspiration pour l’agriculture peut être vue comme un retour en arrière dans les familles qui sont parvenues à s’extraire de la condition paysanne, surtout lorsqu’elle est exprimée par celles et ceux qui ont des diplômes plus valorisables sur le marché du travail.
Des désaccords ou des tensions peuvent aussi apparaître sur le type d’agriculture défendue. En effet, le retour à l’agriculture ne signifie pas une reproduction à l’identique des modèles familiaux d’exploitation. Plusieurs enquêtés font part des échanges parfois vigoureux avec leurs proches sur ces questions, certains renonçant finalement à s’installer sur les terres des grands-parents pour éviter un conflit familial.
Devenir ouvrier agricole
Si l’installation rapide après la formation concerne une faible proportion des anciens stagiaires, les situations d’attente sont les plus répandues. Une fois la formation terminée, vient le temps des premières confrontations avec les organisations professionnelles agricoles, plus particulièrement pour celles et ceux qui n’ont pas d’attaches avec le milieu et sont à la recherche d’opportunités foncières. Contrairement à ce que beaucoup espéraient, parmi les désenchantés principalement, le diplôme ne suffit pas à assurer une légitimité auprès des acteurs agricoles traditionnels. Et ces déconvenues ne s’expérimentent pas uniquement auprès des organisations dominantes du secteur. En effet, le passage par la formation participe à transmettre aux stagiaires des connaissances productives pouvant aller à l’encontre des initiatives militantes auxquelles ils avaient adhéré avant d’entrer en formation. Le passage par le BPREA place donc les anciens stagiaires dans une position d’entre-deux. Socialisés aux contraintes économiques et agronomiques du métier, ils n’adhèrent plus aux modèles les plus hétérodoxes, comme la permaculture, qu’ils valorisaient pourtant jusque-là. Dans le même temps, l’obtention d’un diplôme agricole ne leur suffit pas à avoir une pleine légitimité auprès des structures agricoles traditionnelles. Sans être extérieurs aux mondes agricoles ni en faire complètement partis, les anciens stagiaires trouvent dans les réseaux de l’agriculture biologique et paysanne un groupe de référence.
Face à ces difficultés, certains anciens stagiaires deviennent ouvriers agricoles et leurs revenus sont alors inférieurs à ceux qu’ils tiraient de leur ancien emploi, surtout pour les désenchantés qui occupaient des positions professionnelles à responsabilité. De plus, ce type d’emploi est souvent précaire et à temps partiel, du fait de la saisonnalité du travail agricole13, ce qui est éprouvant pour celles et ceux qui avaient auparavant des emplois stables. Cela pèse aussi sur la sphère familiale. Plusieurs stagiaires suivis ont connu des séparations durant ce moment de transition.
Pour les autres, comme les déclassés, qui avaient déjà connu cette instabilité professionnelle au cours de leur carrière, la discontinuité du travail agricole paraît moins contraignante. Au contraire, elle constitue parfois une opportunité pour connaître plusieurs modèles d’exploitation agricole et choisir celui qui leur correspond le mieux avant de s’installer.
Le renoncement
Le troisième type de parcours se caractérise par un abandon du projet agricole initial. Parfois momentané, le renoncement se traduit par un retour dans son ancien emploi ou par de nouvelles tentatives de reconversion. Même dans ces cas, le passage par le BPREA n’est pas sans incidence. La fréquentation de l’organisme de formation et la détention d’un nouveau titre scolaire ont des conséquences sur les parcours professionnels des stagiaires.
Ainsi, le retour dans l’emploi d’origine peut s’apparenter à une véritable épreuve, surtout si la volonté de se reconvertir a été motivée par des difficultés liées aux conditions du travail d’origine. Ayant gardé des contacts dans leur entreprise et face aux contraintes économiques grandissantes, certains reprennent finalement leur activité initiale, mais en tant qu’indépendants. Les connaissances acquises pendant la formation leur permettent d’envisager autrement leur rapport au travail, même lorsqu’ils ont été salariés toute leur vie. Avec ce nouveau statut d’indépendant, il s’agit pour eux de consacrer plus de temps à des projets agricoles non rémunérateurs, tout en poursuivant leur activité professionnelle.
Pour d’autres, le passage par la formation et l’obtention du BPREA procurent une « nouvelle autorité » et une compétence statutaire14 une fois revenus dans l’entreprise initiale. En faisant valoir leurs nouvelles connaissances techniques (« la fabrication des légumes ») et managériales, certains peuvent accéder à une petite mobilité professionnelle ascendante15.
Conclusion
Le rôle de la formation continue ne se résume pas à l’enseignement de compétences scientifiques ou techniques. Étape intermédiaire importante au sein des mobilités professionnelles vers l’agriculture, et pourtant peu étudiée, elle contribue aussi à l’élaboration d’un projet professionnel « réalisable ». Bien que confrontés à une forte incertitude, les apprenants doivent alors se projeter dans un univers professionnel spécifique.
Étudier des reconversions professionnelles en cours vers le maraîchage biologique a permis de rendre compte des trajectoires souvent peu visibles. Les reconversions professionnelles vers ce secteur ne sont pas uniquement le fait d’anciens cadres qui, étant parvenus à créer leur propre exploitation agricole, disposent souvent d’une visibilité médiatique importante. Elles concernent aussi de jeunes employés qui trouvent dans des postes d’ouvriers agricoles des positions de reclassement. D’autres enfin finissent par renoncer, mais le passage par la formation continue n’est néanmoins pas sans effet : il peut renforcer le souhait d’indépendance et faciliter des mobilités professionnelles ascendantes dans les métiers d’origine. En participant à ouvrir les frontières entre le groupe agricole et les autres espaces socio-professionnels, la formation continue publique agricole est un instrument contribuant au renouvellement des actifs en agriculture.
Jean-Baptiste Paranthoën
Inrae-Irisso
Notes de bas de page
1 - Campi, M. et al., 2024, « The evolving profile of new entrants in agriculture and the role of digital technologies, OECD Food », Agriculture and Fisheries Papers, No. 209, OCDE, https://doi.org/10.1787/d15ea067-en.
2 - Purseigle F., Hervieu B, 2022, Une agriculture sans agriculteurs, Presses de Sciences Po.
3 - Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 2023, Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture, dossier de presse, 15 décembre.
4 - Paranthoën J.-B., 2014, « Déplacement social et entrées en agriculture. Carrières croisées de deux jeunes urbains devenus maraîchers », Sociétés contemporaines, n° 96, pp. 51-76.
5 - Ministère de l’Agriculture, Portrait de l’enseignement agricole, 2020.
6 - Méthode de recueil d’informations qui consiste à faire partie du contexte étudié et à y côtoyer les acteurs. Dans notre cas, nous avons participé à plusieurs modules de formation ainsi qu’à des moments collectifs (repas, trajets en voiture).
7 - Au moment de l’enquête ce fonds s’appelait FONGECIF. Depuis 2020, il s’intitule Transitions Pro.
8 - Berthet T., 2010, « Externalisation et gouvernance territoriale des politiques actives de l’emploi », Revue française de socio-économie, n° 6, p. 131-148.
9 - Mahé M., 2017, L’enseignement technique agricole : diplômes, insertions et perspectives d’emploi, Analyse n° 109, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Centre d’études et de prospective.
10 - Denave S., 2015, Reconstruire sa vie professionnelle. Sociologie des bifurcations biographiques, Presses universitaires de France.
11 - Pour la promotion 2017/2018, seules deux personnes sur 30 n’ont pas eu leur diplôme, dont une pour cause d’abandon.
12 - Barral S., Pinaud S., 2017, « Accès à la terre et reproduction de la profession agricole. Influence des circuits d’échange sur la transformation des modes de production », Revue française de socio-économie, n° 18, pp. 77-99.
13 - Roux N., 2022, La précarité durable, PUF.
14 - Bourdieu P., 1979, « Les trois états du capital culturel », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 30, pp. 3-6.
15 - Pour approfondir, Paranthoën J.-B., 2021, « La formation continue publique en agriculture : mission impossible pour les Centres de formation pour la promotion agricole ? », Sociologie du travail, vol. 63, n° 4 ; Paranthoën J.-B., 2021, « Des reconversions professionnelles en train de se faire vers le maraîchage biologique. Ethnographie d’une formation », Travail et emploi, n° 166-167(3), pp. 103-129 ; Paranthoën J.-B., 2024, « Quand la porte des champs se referme. Logiques et limites de la reconversion du capital scolaire en agriculture », dans François Buton, En déplacement : le passage des frontières professionnelles en question, ENS Lyon, pp. 30-47.
Voir aussi
Qui s’installe en agriculture aujourd’hui ? - Analyse n°215
10 juin 2025CEP | Centre d’études et de prospective

Temps de travail et temps de vie des exploitants agricoles : quelles différences selon l’origine sociale ? - Analyse n°217
10 juin 2025CEP | Centre d’études et de prospective

Les installés « non issus du milieu agricole » : des producteurs comme les autres ? - Analyse n°218
10 juin 2025CEP | Centre d’études et de prospective

Agriculteurs « non issus du milieu agricole » en Bourgogne-Franche-Comté : trajectoires biographiques et entrées en agriculture - Analyse n°216
10 juin 2025CEP | Centre d’études et de prospective

Devenir agricultrice en Quercy : entre recomposition et persistance des inégalités de genre - Analyse n°214
10 juin 2025CEP | Centre d’études et de prospective

#ActifAgri : De l'emploi à l'activité agricole : déterminants, dynamiques et trajectoires
02 mars 2020CEP | Centre d’études et de prospective