
François Purseigle : « Il faut réconcilier les Français avec leurs agricultures »
Partager la page
Professeur des universités en sociologie à l’AgroToulouse et chercheur associé au CEVIPOF à Paris, François Purseigle partage son analyse des grandes mutations en cours dans le monde agricole, entre recul du modèle familial historique, éclatement des structures d’exploitation et place grandissante faite au salariat.
Pouvez-vous dresser un panorama des grandes évolutions à l’œuvre dans l’agriculture française ?
Je vois trois types de défis à relever et à conjuguer : sociaux, entrepreneuriaux et territoriaux. Il y a d’abord un effacement démographique sans précédent, qui va se poursuivre avec le départ à la retraite prochain d’environ 200 000 exploitants. D’un point de vue démographique, on n’est pas au pied du mur: on est déjà dedans. Deuxième élément, il y a un éclatement, une diversification des structures d’exploitation qui sont tout à la fois commerciales, artisanales, industrielles, patrimoniales… Toutes ces entreprises font face à de nouveaux défis, celui de la gestion des incertitudes et des risques et celui de la consolidation et de la mise en adéquation entre porteurs de projets et entreprises à reprendre. Enfin, le troisième point relève de la place des agriculteurs dans les territoires, où leur pouvoir est de plus en plus disputé par d’autres groupes sociaux et où leurs activités ne vont plus de soi : au moment même où ils en sont de moins en moins issus, la plupart des Français se sentent légitimes à parler d’agriculture. Les défis sont donc aussi territoriaux : celui de la sécurisation et de la reterritorialisation des filières mais aussi celui de la coexistence et de la gestion de la concurrence pour l’accès aux ressources.
Vous évoquez un éclatement des structures d’exploitation. Peut-on en dire autant des métiers agricoles ?
Absolument. Dans l’esprit des Français, agriculteur signifie chef d’une exploitation familiale, construite autour d’un couple. L’imaginaire collectif a du mal à s’arracher à cette vision issue de notre histoire: jusque dans les années 1980-1990, les structures familiales étaient la norme. Or, ce modèle ne concerne plus que 20% des installations! Aujourd’hui, le salariat occupe une place grandissante, au sein de l’exploitation et à l’extérieur: groupements d’employeurs, entreprises de travaux agricoles, intérim, etc. Les mouvements sont multiples, les salariés viennent d’autres secteurs, y retournent, on peut être à la fois exploitant dans une structure et salarié dans une autre… L’agriculture est synonyme d’une grande fluidité dans les statuts et les métiers.
« Le défi pour les politiques publiques est de viser le renouvellement des chefs d’exploitation, mais aussi de tous les actifs agricoles »
Ce recours au salariat remet-il en cause le rôle du chef d’exploitation ?
La réussite des entreprises agricoles va dépendre de la capacité des chefs d’exploitation à ne plus tout faire, de la conduite de tracteur à la comptabilité, en passant par la réparation du matériel ou la vente sur les marchés, mais à s’appuyer sur des salariés qui ne seront plus de simples exécutants. Il faut que les salariés agricoles montent en compétences, avec toute la réorganisation que cela implique. La loi d’orientation agricole acte ce changement avec la création d’un bachelor à Bac+3, à l’interface du technicien supérieur et de l’ingénieur, qui a vocation à former les cadres intermédiaires qui manquent tant aux entreprises agricoles.

Quelles conséquences ce remodelage des métiers a-t-il dans l’optique du renouvellement des générations ?
Le défi, pour les politiques publiques, est de viser le renouvellement des chefs d’exploitation, bien sûr, mais aussi de tous les actifs agricoles que je viens d’évoquer, dans leur diversité de territoires, de filières, de métiers. En tenant compte de cette fluidité, de cette multi-appartenance. Enfin, si l’enjeu de l’installation est important, celui de conforter les entreprises l’est tout autant: c’est une réflexion plus large.
Comment le monde agricole appréhende-t-il ces changements ?
Les mobilisations de l’hiver 2024 ont montré que le monde agricole n’est pas au clair sur ses attentes. Dans la colère qui s’est exprimée, on pouvait observer trois types d’aspirations : celle d’être reconnus pour ce qu’ils sont et de pouvoir vivre de leur métier ; celle d’être soutenu pour changer de modèles, ou encore celle d’être reconnu économiquement en qualité de chefs d’entreprise… Mais toutes et tous aspirent à maintenir la France en situation de souveraineté, à contribuer à un effort productif.
Qu’en est-il du regard de la société française sur son agriculture ?
C’est assez paradoxal: les sondages montrent que le mouvement de contestation de l’hiver 2024 a été largement soutenu par l’opinion publique, mais dans le même temps les agriculteurs ressentent un effritement de ce soutien, réclament en quelque sorte des preuves d’amour. En tout cas, il y a un enjeu à réconcilier les Français avec leurs agricultures, au pluriel. Il faudra rompre avec certaines images fantasmées de l’agriculture et changer un regard qui reste trop souvent condescendant, méfiant, voire accusateur a priori. Il faut arrêter de ne voir l’agriculture que comme un problème,reconnaitre son caractère stratégique et admettre qu’il faut faire coexister des entreprises agricoles aux ambitions diverses, pour rendre la ferme France plus compétitive et plus résiliente à l’avenir.
Voir aussi
Installation-transmission : qui sont les acteurs clés ?
26 août 2025Installation et transmission
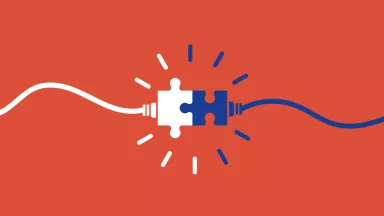
Nouvelles générations : préparer la relève
27 août 2025Installation et transmission

Vers une hybridation du métier d’agriculteur
26 août 2025Installation et transmission
