
Stratégie Écophyto 2030 : le Gouvernement partage un premier bilan en Comité d’orientation stratégique et de suivi afin de réduire l’utilisation et les risques des produits phytosanitaires et soutenir les filières agricoles
Partager la page
Le comité d’orientation stratégique et de suivi (COS) de la Stratégie Écophyto 2030 s’est réuni ce jour. Cette réunion était présidée par la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche et le ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, le ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec le représentant du ministre des Outre-Mer. Un an après la publication de cette stratégie, le gouvernement dresse un premier bilan encourageant : un indicateur de risque en baisse de 36 %, 143 millions d’euros engagés dans la recherche et le développement de solutions alternatives, une feuille de route territorialisée dans quatre régions pilotes et le lancement d’actions ciblées sur les sites Natura 2000.
C’est d’abord un changement de méthode qui a été consacré, autant dans l’ampleur des actions et des moyens mis en œuvre en 2024 que dans l’approche, fondée sur l’accélération de la recherche d’alternatives, le soutien aux agriculteurs engagés dans les évolutions de leurs pratiques, l’importance de la concertation pour les actions ciblées et prioritaires sur les zones à enjeux pour la santé humaine et l’environnement.
Parmi les avancées principales :
-
La concrétisation du Plan pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives de protection des cultures (Parsada). Il s’agit de créer une nouvelle dynamique de co-construction publique-privée de projets de recherche pour aboutir à des solutions transférables aux agriculteurs sur l’ensemble des filières de production végétales, y compris les filières ultra-marines. Le rôle des instituts techniques est capital pour l’application au champ de ces recherches d’alternatives, et accompagner les filières confrontées aux impasses : une première vague de 14 plans d’action élaborés au sein de huit filières a été lancée, avec 28 projets multi-partenariaux retenus après avis d’un comité scientifique et technique de haut niveau. Ce sont au total 143 millions d’euros engagés par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire dans le cadre de son budget de planification écologique.
-
Dans le cadre de la mise en œuvre du décret relatif à l’encadrement de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les sites Natura 2000 terrestres, des travaux ont été conduits cette année par les services déconcentrés de l’Etat pour identifier les aires protégées à enjeux et les mesures à prendre pour réduire la pression et atteindre les objectifs de conservation ou de restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés. Parmi ces travaux, on peut citer : l’analyse de la pression des produits phytosanitaires dans 1 596 sites Natura 2000 disposant d’une partie terrestre, l’Identification de la population des sites Natura 2000 pour lesquels une pression de la part des produits phytopharmaceutiques est avérée, la définition des mesures contractuelles à prendre pour accompagner les agriculteurs à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires dans les sites Natura 2000 à enjeux, le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt par l’Office français de la biodiversité, dans le cadre de la Stratégie nationale biodiversité, à hauteur de 450 000€ permettant de sélectionner trois territoires pilotes couvrant des sites Natura 2000 et des aires d’alimentation de captages (AAC) et la mise en place d’une expérimentation par l’INRAE dans les régions Centra-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté, pour la période 2024-2026, à hauteur de 300 000€ afin de déployer un modèle de gouvernance locale concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000.
-
La construction d’une méthodologie afin de décliner la Stratégie Écophyto 2030 à l’échelle territoriale, au plus près des territoires, et le lancement des diagnostics territoriaux dans quatre régions pilotes (Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe et Réunion).
-
La recherche a été fortement mobilisée, avec une implication importante des équipes INRAE dans les appels Ecophyto R&I et Parsada. Les principaux axes incluent l’amélioration génétique pour des variétés tolérantes ; la modélisation des épidémies ; le développement de solutions de lutte biologique incluant les régulations naturelles et le biocontrôle (microorganismes, écologie chimique, plantes de service, cultures compagnes) ; et le microbiote (rôle protecteur).
Accéder au dossier de presse Stratégie Écophyto 2030 : une année d'actions
Des progrès et des perspectives
L’indicateur de référence retenu pour évaluer la stratégie est l’indicateur de risque harmonisé européen HRI1. Sa valeur pour l’année 2022 a été présentée1 lors du COS. Elle s’élève à 64, en baisse de 36 % par rapport à la période de référence (2011-2013). Cette baisse traduit l’effectivité des retraits européens d’approbation de substances actives ainsi que les efforts nationaux mis en œuvre pour réduire l’utilisation et les risques liés à l’emploi de produits phytopharmaceutiques, notamment au travers des plans Écophyto successifs. Des indicateurs complémentaires, dont certains sont à construire, ont été présentés pour suivre l’ensemble des actions de la Stratégie.
Le COS a également été l’occasion de présenter les grandes lignes des recommandations de l’INRAE à la suite de sa saisine par les ministres sur les évolutions possibles de l’indicateur HRI1. Le rapport est rendu public ce jour.
Le Gouvernement a enfin réaffirmé son plein engagement dans la mise en œuvre de la Stratégie Ecophyto 2030, via différents chantiers structurels.
L’appel à projets « Prise de Risque Amont Aval et Massification de pratiques visant à réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques sur les exploitations agricoles » (PRAAM), dispositif novateur, a d’ailleurs été doté de 90 millions d’euros, et vient d’être lancé, en s’inspirant des projets déposés dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt lancé en juillet 2024. Il a pour objectif d’accompagner le passage entre le stade de la recherche appliquée et la généralisation auprès des agriculteurs des méthodes éprouvées.
Parmi les priorités pour 2025, ont été citées :
-
la promotion d’une définition européenne du biocontrôle et des procédures d’approbation accélérées ainsi qu’une action de stratégie d’influence au niveau européen (harmonisation et clauses miroirs) ;
-
la territorialisation de la stratégie Écophyto pour répondre aux problématiques identifiées au plus proche du terrain, avec notamment une gouvernance spécifique pour l’outre-mer ;
-
la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale pour l’amélioration de la qualité de l’eau par la protection des captages avec la réalisation d’un état des lieux sur les captages d’eau potable prioritaires ;
-
l’évaluation et l’évolution le cas échéant des réseaux existants de massification, 15 ans après la création des fermes DEPHY ;
-
la poursuite du PARSADA, avec une deuxième vague de plans d’actions pour 2025 ;
-
la poursuite du déploiement au niveau régional d’un dispositif d’information sur l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la création d’un portail national, ainsi que la réunion du comité de suivi des études nationales sur les pesticides d’ici la fin de l’année pour présenter les résultats des études portant sur les impacts des pesticides sur la santé ;
-
la coordination outre-mer de la stratégie Ecophyto 2030 et l’évaluation des outils de financement des politiques agricoles spécifiques aux territoires ultramarins (POSEI notamment).
Un an après le lancement de notre stratégie visant à réduire de 50 % l’usage des produits phytosanitaires et les risques qui y sont liés, les avancées sont importantes : concrétisation du PARSADA, encadrement de l'utilisation des produits phytosanitaires dans les sites Natura 2000 terrestres, déclinaison territoriale de cette stratégie. Au travers des plans Ecophyto successifs, nous progressons : l'indicateur de référence européen utilisé pour évaluer la stratégie, l'indicateur de risque harmonisé 1 (HRI1), s’élève à 64 en 2022, en baisse de 36 % par rapport à la période de référence (2011-2013). En 2023, on note une baisse de 97% des ventes des substances les plus à risque (CMR1) par rapport à la période de référence 2015-2017. Depuis 2022, enfin, le nombre des captages fermés pour cause de présence de pesticides se stabilise. Mais nous devons poursuivre nos efforts car les agriculteurs sont les premières victimes de la baisse des rendements liés à l’appauvrissement des sols et à l’effondrement de la biodiversité. Avec comme boussole la science et un dialogue constant avec nos agriculteurs, je souhaite, en 2025, que nous poursuivions nos efforts concernant l'encadrement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques notamment dans les sites Natura 2000 et les aires d’alimentation de captage, tout en déployant des alternatives concrètes et efficaces pour nos agriculteurs, et en les protégeant contre la concurrence déloyale de produits cultivés ailleurs avec des produits interdits en France et en Europe.
Les agricultrices et agriculteurs sont les premiers concernés par cette Stratégie, conscients et acteurs chaque jour de la nécessité de réduction d’utilisation et des risques. Ils ont besoin d’être soutenus, accompagnés dans cette transition pour une agriculture plus durable tout en garantissant la souveraineté alimentaire de notre pays. L’Etat a un rôle déterminant à cet égard pour soutenir les filières dans la transition climatique et environnementale. Grâce à une approche collective et innovante, que ce soit par le PARSADA dont je vais lancer une seconde vague en 2025, le développement des outils intelligents et de précision, ou l’appui à plus d’agronomie dans les pratiques, nous avançons vers des solutions concrètes qui préservent à la fois notre agriculture, notre santé et notre environnement. Il s’agit là d’une question collective essentielle, pour élargir la palette des solutions mises à disposition des agriculteurs qui ne doivent plus se retrouver sans solution alors qu’ils ont la mission de nous nourrir. A nous tous, Etat, citoyens, parties prenantes, de reconnaitre leurs efforts pour produire en préservant la santé et l’environnement, car rien n’est plus décourageant sinon. La transition nécessite l’engagement de tous, car soutenir l’agriculture c’est soutenir l’environnement – en ce sens il faut redoubler d’efforts pour proposer des alternatives robustes, efficaces et viables économiquement pour ne pas laisser des filières dans des impasses.
Les produits phytosanitaires répondent à des besoins qu’il doit être possible de combler par d’autres moyens, sans renoncer à l’efficacité de notre agriculture. Nous devons avancer dans notre compréhension des effets globaux des phytosanitaires, afin de proposer les alternatives les plus efficaces. Pour ce faire, un investissement résolu dans la recherche et l’innovation est nécessaire. La nouvelle étape de la stratégie Ecophyto est une opportunité pour réaffirmer l’engagement de la France en faveur de sa recherche dans ce domaine. Nous avons la chance d’avoir des chercheurs et des laboratoires de très haut niveau, sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour faire avancer la science, au service de notre santé et de notre bien-être collectifs.
Plusieurs études françaises et internationales ont mis en évidence des liens entre l’exposition aux pesticides et le risque d’apparition de pathologies cancéreuses, neurologiques ou encore de troubles de la reproduction. Je souhaite une transparence totale sur le sujet et m’engage à ce que le ministère de la santé réunisse d’ici la fin de l’année le comité de suivi des études nationales sur les pesticides – associant toutes les parties prenantes –, pour faire le point sur nos connaissances et pour partager les derniers résultats des études portant sur les impacts des pesticides sur la santé. Sans attendre, il est nécessaire de renforcer notre action pour limiter l’exposition de la population et de l’environnement aux pesticides et mieux informer. En 2025, je souhaite que le ministère chargé de la santé, en lien avec les ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie, travaille à la création d’un portail national d’information sur l’exposition des riverains aux produits phytopharmaceutiques et incite au déploiement de dispositifs régionaux pour répondre aux questions et attentes de nos concitoyens.
1 L’indicateur HRI1 est calculé par Eurostat, pour une publication des résultats de l’année N en année N+2. Ce délai s’explique par le fait que la classification des substances actives de l’année N n’est disponible qu’à l’année N+2.
À télécharger
Contacts presse
Service de Presse d'Agnès Pannier-Runacher
Tél : 01 40 81 86 16
presse.apr@ecologie.gouv.fr
Service de presse d'Annie Genevard
Tél : 01 49 55 59 74
cab-presse.agriculture@agriculture.gouv.fr
ministere.presse@agriculture.gouv.fr
Service de presse de Philippe Baptiste
Tél : 01 55 55 82 00
presse-mesr@recherche.gouv.fr
Service de presse de Yannick Neuder
Tél : 01 87 05 97 89
sec.presse.sas@sante.gouv.fr
Voir aussi
Développement des alternatives aux produits phytopharmaceutiques : le comité inter-filières du PARSADA valide cinq nouveaux plans d’actions
23 mai 2025Transitions et adaptation

Dossier de presse - Stratégie Écophyto 2030 : une année d'actions
16 juillet 2025Transitions et adaptation
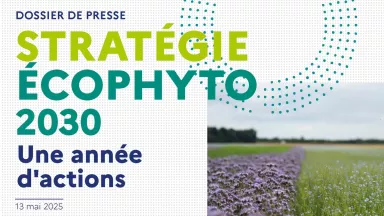
Stratégie Écophyto 2030
06 mai 2024Transitions et adaptation

Les indicateurs de suivi de la stratégie Écophyto 2030
14 octobre 2025Transitions et adaptation

Les indicateurs de risque harmonisés établis au niveau européen
14 octobre 2025Santé / Protection des végétaux

